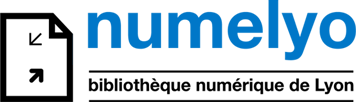Eugène Grasset, 1845-1917. Le renouveau des arts décoratifs
« Je fais seulement et toujours décoratif ». - Artiste pluriel, étonnant touche-à-tout d’une extrême rigueur technique, Eugène Grasset fut à la fois peintre, sculpteur, décorateur (dessinant et concevant des pièces de textile ou d’ameublement, des bijoux, vitraux, céramiques…), dessinateur et affichiste, mais reste surtout l’un des plus grands théoriciens des arts décoratifs en cette fin de siècle.
Né à Lausanne d’un père ébéniste et décorateur, E. Grasset étudie successivement le dessin puis l’architecture. Esprit curieux, il se forge rapidement une culture artistique plurielle, puisant à la fois dans ses connaissances archéologiques, ethnographiques, dans ses souvenirs de voyages (sa découverte de l’Egypte marquera durablement son style) ou encore dans sa formation technique. Après quelques travaux pour le Théâtre de Lausanne (entre 1869 et 1871), il s’installe à Paris où il réalise diverses commandes de dessin décoratif pour l’ameublement, la tapisserie, la céramique ou la joaillerie.
Très vite, il noue des liens féconds qui nourriront sa conception pluridisciplinaire des Arts. Il se lie notamment à Félix Gaudin, peintre, verrier et mosaïste, dont il restera proche jusqu’à sa mort et avec lequel il créera une centaine de vitraux. De même, il rencontre Charles Gillot, grand collectionneur d’art japonais (dont on trouve souvent l’influence dans le dessin de Grasset), imprimeur et graveur-typographe, et qui mit au point le procédé d’impression couleurs sur plaque de zinc auquel il laissa son nom. Le « gillotage », ou chromotypographie, mère de la photogravure moderne, libère ainsi les artistes de la gravure sur les lourdes pierres lithographiques et permet l’impression de plus grands formats. Eugène Grasset est le premier illustrateur à utiliser la nouvelle technique.
C’est en 1883 que paraît L’Histoire des quatre Fils Aymon [note], emblème du livre illustré moderne tant par sa qualité et son avant-gardisme graphiques que par la prouesse technique dont elle est le fruit. Il s’agit en effet du premier ouvrage précisément imprimé en chromotypographie, procédé permettant d’imprimer simultanément texte et images de plusieurs couleurs, accordant ainsi à l’artiste une grande liberté de composition. Le champ visuel du texte et celui de l’image peuvent se jouer l’un de l’autre, se superposer, se répondre ou déborder dans une relation inédite.

Grasset, Eugène-Samuel, L’Histoire des quatre Fils Aymon illustrée par Eugène Grasset […], Paris, H. Launette, 1883. (BmL, SJB 107/12)
En 1890, E. Grasset dessine pour les éditions Larousse La Semeuse, qui deviendra l’emblème visuel de la marque jusqu’en 1950 et qui, régulièrement re-dessinée (re-designée), reste encore aujourd’hui un symbole collectif. On retrouve d’ailleurs en elle les principales marques ornementales de l’artiste telles l’association femme-fleur ou les jeux de lignes et de mouvements.

Grasset, Eugène-Samuel, Nouveau Larousse illustré en six volumes, Paris, Larousse, 1897. Lithographie, 57 x 38 cm. (BmL, AffP0100)
À cette époque, la renommée de l’artiste est déjà grande ; alors mondialement connu, on le dit même précurseur de l’Art Nouveau aux Etats-Unis où il collabore à différentes revues (Harper’s Magazine ou The Century Magazine).
C’est cette force graphique toute particulière qui permet à Grasset, malgré la petite quantité d’œuvres produites, de compter aujourd’hui parmi les plus grands noms de l’affiche. Sa première affiche sort des presses lithographiques d’Appel en 1885, elle illustre les « Fêtes de Paris », et ses travaux dans ce domaine vont se poursuivre jusqu’au début du XXe siècle.
Ses premières affiches sont construites comme des tableaux et son style le démarquera très vite des affichistes en vogue de l’époque. En effet, là où Jules Chéret utilise la présence récurrente, voire systématique, d’un personnage féminin (la « Chérette ») dont la gaieté d’expression et le pétillement enjoué provoquent l’attention des passants, Eugène Grasset développe progressivement un type féminin proche de la « Muse » (Muse de la Lecture pour La Librairie Romantique (1887), Muse des Connaissances pour La Semeuse (1890), Muse de l’Ecriture pour L’encre Marquet (1892), Muse de la Sculpture pour l’affiche d’Exposition A. Falguière (1898), etc.). Souvent figurée de trois-quarts ou de profil, chevelure abandonnée aux vents, s’intégrant à une nature fortement stylisée (nuages, vent, jardins), elle annonce déjà la femme de Mucha dont on retrouve « l’élégance raffinée des toilettes, les méandres de leurs chevelure, la pâleur satinée et leurs regards songeurs » [note].

Grasset, Eugène-Samuel, Salon des Cent, Paris, G. de Malherbe, 1894. Lithographie, 61 x 42 cm. (BmL, AffP0023)
Cette présence féminine, symbolique, dispense l’artiste d’une surcharge de texte et laisse à l’ensemble une forte liberté graphique dans sa structure. Les compositions d’Eugène Grasset sont d’ailleurs souvent marquées par un rapport audacieux entre le texte et l’image, chacune de ces deux composantes jouant un rôle propre dans la structure d’ensemble. Ainsi, pour l’affiche de L’Encre Marquet, tout comme pour celle de La Librairie romantique, on retrouvera son personnage central adossé au panneau publicitaire de la marque ; pour l’affiche réalisée pour la représentation théâtrale de Sarah Bernhardt, le nom de la comédienne s’est lui aussi intégré à l’un des éléments du décor (le socle sur lequel est campée sa « Jeanne d’Arc »).

Grasset, Eugène-Samuel, Encre L. Marquet, la meilleure de toutes les encres, Paris, G. de Malherbe, 1892. Lithographie, 121 x 81 cm. (BmL, AffM0118)

Grasset, Eugène-Samuel, Librairie romantiques, Paris, J. Bognard Jne, 1887. Lithographie, 131 x 90 cm. (BmL, AffG0027)
Il est un des premiers à parler d’accrocher le regard, considérant qu’une affiche ne se lit pas et qu’elle doit mettre en évidence l’originalité de l’objet qu’elle est chargée de recommander ; elle se doit donc d’être frappante par sa construction graphique (pureté des lignes, simplification des formes, aplats de couleurs). Il confie d’ailleurs lui-même : Je n’hésite pas à faire des cheveux verts ou rouges si ces couleurs s’harmonisent dans une composition car je considère la figure […] comme un ornement, au même titre qu’une fleur, un nuage ou un animal. [note].
C’est précisément cette liberté de représentation du réel qui lui valut quelque différend avec Sarah Bernhardt et pour laquelle il dut rectifier l’affiche la représentant en Jeanne d’Arc. Jules Adeline rapporte à ce sujet [note] une anecdote pour l’édification des collectionneurs : Sur le dessin original […] l’actrice était très ressemblante ; mais elle, ou plutôt son entourage ne le trouvait point ainsi. Le dessinateur dut retoucher son dessin […]. Existe-t-il des épreuves de premier état avec la première tête ? Ces tirages existent bel et bien et c’est précisément l’un de ces exemplaires rares que conserve la Bibliothèque municipale de Lyon.

Grasset, Eugène-Samuel, Jeanne d'Arc, Paris, Imp. Draeger et Lesieur ; Verdoux, Ducourtioux et Huillard sc., 1890. Zincographie, 120 x 74 cm. (BmL, AffM0110)
E. Grasset suit donc de près les progrès des arts graphiques et son talent d’artiste accompagne les développements techniques et industriels de son temps (utilisation de l’impression couleurs en photogravure, participation à deux revues majeures, Art et Décoration et L’Estampe et l’Affiche, dans lesquelles il défend et propose un regard novateur sur la construction de l’image, création d’un alphabet typographique pour G. Peignot en 1898 qui sera présenté à l’Exposition Universelle de 1900). Pour la réalisation de ses multiples projets, il aimait s’entourer des meilleures maisons, collaborer avec les plus grands techniciens et artistes de son temps - Vever pour les bijoux, Fulfgraff pour les travaux d’ébénisterie, Félix Gaudin pour les vitraux, Emile Muller pour l’émail, les ateliers de tissages Leclercq, … - et l’on sait avec quel soin il suivait processus de réalisation jusque dans ses moindres détails.
Il est alors l’un des principaux théoriciens des « Arts Décoratifs », et son objectif est de resserrer les liens entre les arts et les arts appliqués. On le retrouve donc participant à de nombreuses organisations officielles toutes soucieuses de mettre en marche cette révolution esthétique (Société des artistes décorateurs dont il est le fondateur aux côtés de l’architecte H. Guimard, Société nationale des Beaux-Arts, entre autres). En cette fin de siècle marquée par le développement des industries, il confie ainsi que L’Art Nouveau existera surtout quand les machines, jusqu’ici employées par les ingénieurs, le seront aussi par les artistes. [note]
Par ailleurs, il enseigne le dessin industriel et la composition décorative (de 1890 à 1903) ou l’Histoire et le Dessin de la lettre (Ecole Estienne, de 1905 jusqu’à sa mort). Il publie également deux « sommes » méthodologiques : La Plante et ses applications ornementales (1895) et La méthode de composition ornementale (1905). Ces ouvrages resteront une source, pédagogique, technique et artistique, pour de nombreux artistes, ce qu’il assume pleinement en déclarant : Nous avons travaillé surtout pour le futur. [note]
C’est sans nul doute cette connaissance pratique, accompagnée d’une profonde exigence technique, confortée par une vision théorique d’ensemble qui lui permit véritablement de s’affranchir pour ne plus se soucier que de la ligne et qui le consacrera comme l’un de ces faiseurs de temps, celui de l’Art Nouveau.
- Institution des Arts Décoratifs (Paris) : Biographie d’Eugène Grasset
- Musée Cantonal des Beaux-Arts (Lausanne) : Œuvres commentées d’E. Grasset
- La collection d'affiches numérisées d'Eugène Grasset
- Liste des ouvrages écrits ou illustrés par Eugène Grasset
- A. Murray-Robertson, Grasset, pionnier de l’Art Nouveau. Paris, Bibliothèque des Arts, Lausanne, Éd. 24 heures, 1981.
- Catherine Lepdor, Eugène Grasset, 1845-1917. Exposition au Musée Cantonal des Beaux-Arts. Lausanne, 2011.
- Nicholas-Henry Zmelty, L’Affiche illustrée au temps de l’affichomanie. Paris, Mare et Martin Arts, 2014.
- Eugène Grasset et son œuvre. Paris, Éd. de La Plume, 1900.